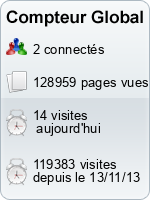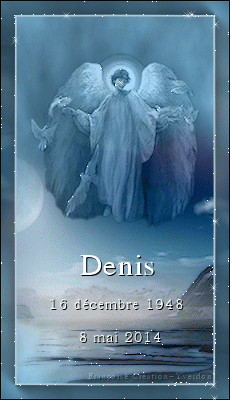-
Par sylvie erwan le 13 Juillet 2019 à 08:30

♥

Le 13 Juillet
La joie est ici-bas toujours jeune et nouvelle,
Mais le chagrin n’est vrai qu’autant qu’il a vieilli.
À peine si le prince, hier enseveli,
Commence à s’endormir dans la nuit éternelle ;
L’ange qui l’emporta n’a pas fermé son aile ;
Peut-être est-ce bien vite oser parler de lui.Ce fut un triste jour, quand, sur une civière,
Cette mort sans raison vint nous épouvanter.
Ce fut un triste aspect, quand la nef séculaire
Se para de son deuil comme pour le fêter.
Ce fut un triste bruit, quand, au glas funéraire,
Les faiseurs de romans se mirent à chanter.Nous nous tûmes alors, nous, ses amis d’enfance.
Tandis qu’il cheminait vers le sombre caveau.
Nous suivions le cercueil en pensant au berceau ;
Nos pleurs, que nous cachions, n’avaient pas d’éloquence,Et son ombre peut-être entendit le silence
Qui se fit dans nos cœurs autour de son tombeau.
Maintenant qu’elle vient, plus vieille d’une année,
Réveiller nos regrets et nous frapper au cœur,
Il faut la saluer, la sinistre journée
Où ce jeune homme est mort dans sa force et sa fleur,
Préservé du néant par l’excès du malheur,
Par sa jeunesse même et par sa destinée.À qui donc, juste Dieu ! peut-on dire : À demain ?
L’Espérance et la Mort se sont donné la main,
Et traversent ainsi la terre désolée.
L’une marche à pas lents, toujours calme et voilée ;
Sur ses genoux tremblants l’autre tombe en chemin,
Et se traîne en pleurant, meurtrie et mutilée.Ô Mort ! tes pas sont lents, mais ils sont bien comptés.
Qui donc t’a jamais crue aveugle, inexorable ?
Qui donc a jamais dit que ton spectre implacable
Errait, ivre de sang, frappant de tous côtés,
Balayant au hasard, comme des grains de sable,
Les temples, les déserts, les champs et les cités ?Non, non, tu sais choisir. Par instants, sur la terre
Tu peux sembler commettre, il est vrai, quelque erreur :
Ta main n’est pas toujours bien sûre, et ta colère
Ménage obscurément ceux qui savent te plaire,
Épargne l’insensé, respecte l’imposteur,
Laisse blanchir le vice et languir le malheur.Mais, quand la noble enfant d’une race royale,
Fuyant des lourds palais l’antique oisiveté,
S’en va dans l’atelier chercher la vérité,
Et là, créant en rêve une forme idéale,
Entr’ouvre un marbre pur de sa main virginale,
Pour en faire sortir la vie et la beauté ;Quand cet esprit charmant, quand ce naïf génie
Qui courait à sa mère au doux nom de Marie,
Sur son œuvre chéri penche son front rêveur,
Et, pour nous peindre Jeanne interrogeant son cœur,
À la fille des champs qui sauva la patrie
Prête sa piété, sa grâce et sa pudeur ;Alors ces nobles mains, qui, du travail lassées,
Ne prenaient de repos que le temps de prier,
Ces mains riches d’aumône et pleines de pensées
Ces mains où tant de pleurs sont venus s’essuyer,
Frissonnent tout à coup et retombent glacées.
Le cercueil est à Pise ; on va nous l’envoyer.Et lui, mort l’an passé, qu’avait-il fait, son frère ?
À quoi bon le tuer ? Pourquoi, sur ce brancard,
Ce jeune homme expirant suivi par un vieillard ?
Quel cœur fut assez froid, sur notre froide terre,
Ou pour ne pas frémir, ou pour ne pas se taire,
Devant ce meurtre affreux commis par le hasard ?Qu’avait-il fait que naître et suivre sa fortune,
Sur les bancs avec nous venir étudier,
Avec nous réfléchir, avec nous travailler,
Prendre au soleil son rang sur la place commune,
De grandeur, hors du cœur, n’en connaissant aucune,
Et, puisqu’il était prince, apprendre son métier ?Qu’avait-il fait qu’aimer, chercher, voir par lui-même
Ce que Dieu fit de bon dans sa bonté suprême,
Ce qui pâlit déjà dans ce monde ennuyé ?
Patrie, honneur, vieux mots dont on rit et qu’on aime,
Il vous savait, donnait au pauvre aide et pitié,
Au plus sincère estime, au plus brave amitié.Qu’avait-il fait, enfin, que ce qu’il pouvait faire ?
Quand le canon grondait, marcher sous la bannière ;
Quand la France dormait, s’exercer dans les camps.
Il s’en fût souvenu peut-être avec le temps ;Car parfois sa pensée était sur la frontière,
Pendant qu’il écoutait les tambours battre aux champs.
Que lui reprocherait même la calomnie ?
Jamais coup plus cruel fut-il moins mérité ?
À défaut de regret, qui ne l’a respecté ?
Faites parler la foule, et la haine, et l’envie :
Ni tache sur son front, ni faute dans sa vie.
Nul n’a laissé plus pur le nom qu’il a porté.Qu’importe tel parti qui triomphe ou succombe ?
Quel ennemi du père ose haïr le fils ?
Qui pourrait insulter une pareille tombe ?
On dit que, dans un bal, du temps de Charles Dix,
Sur les marches du trône il s’arrêta jadis.
Qu’il y dorme en repos, du moins, puisqu’il y tombe !Hélas ! mourir ainsi, pauvre prince, à trente ans !
Sans un mot de sa femme, un regard de sa mère,
Sans avoir rien pressé dans ses bras palpitants !
Pas même une agonie, une douleur dernière !
Dieu seul lut dans son cœur l’ineffable prière
Que les anges muets apprennent aux mourants.Que ce Dieu, qui m’entend, me garde d’un blasphème !
Mais je ne comprends rien à ce lâche destin
Qui va sur un pavé briser un diadème,
Parce qu’un postillon n’a pas sa guide en main.
Ô vous qui passerez sur ce fatal chemin,
Regardez à vos pas, songez à qui vous aime !
Il aimait nos plaisirs, nos maux l’ont attristé.
Dans ce livre éternel où le temps est compté,
Sa main avec la nôtre avait tourné la page.
Il vivait avec nous, il était de notre âge.
Sa pensée était jeune, avec l’ancien courage ;
Si l’on peut être roi de France, il l’eût été.Je le pense et le dis à qui voudra m’en croire,
Non pas en courtisan qui flatte la douleur,
Mais je crois qu’une place est vide dans l’histoire.
Tout un siècle était là, tout un siècle de gloire,
Dans ce hardi jeune homme appuyé sur sa sœur,
Dans cette aimable tête, et dans ce brave cœur.Certes, c’eût été beau, le jour où son épée,
Dans le sang étranger lavée et retrempée,
Eût au pays natal ramené la fierté ;
Pendant que de son art l’enfant préoccupée,
Sur le seuil entr’ouvert laissant la Charité,
Eût fait, avec la Muse, entrer la Liberté.À moi, Nemours ! à moi, d’Aumale ! à moi, Joinville !
Certes, c’eût été beau, ce cri dans notre ville,
Par le peuple entendu, par les murs répété ;
Pendant qu’à l’oratoire, attentive et tranquille,
Pâle, et les yeux brillants d’une douce clarté,
La sœur eût invoqué l’éternelle Bonté.Certes, c’eût été beau, la jeunesse et la vie,
Ce qui fut tant aimé, si longtemps attendu,
Se réveillant ainsi dans la mère patrie.
J’en parle par hasard pour l’avoir entrevu ;
Quelqu’un peut en pleurer pour l’avoir mieux connu ;
C’est sa veuve, c’était sa femme et son amie.Pauvre Prince ! quel rêve à ses derniers instants !
Une heure (qu’est-ce donc qu’une heure pour le Temps ?)
Une heure a détourné tout un siècle. Ô misère !
Il partait, il allait au camp, presque à la guerre.
Une heure lui restait, il était fils et père :
Il voulut embrasser sa mère et ses enfants.C’était là que la Mort attendait sa victime ;
Il en fut épargné dans les déserts brûlants
Où l’Arabe fuyard, qui recule à pas lents,
Autour de nos soldats que la fièvre décime,Rampe, le sabre au poing, sous les buissons sanglants.
Mais il voulut revoir Neuilly ; ce fut son crime.
Neuilly ! charmant séjour, triste et doux souvenir !
Illusions d’enfants, à jamais envolées !
Lorsqu’au seuil du palais, dans les vertes allées,
La reine, en souriant, nous regardait courir,
Qui nous eût dit qu’un jour il faudrait revenir
Pour y trouver la mort et des têtes voilées !Quels projets nous faisions à cet âge ingénu
Où toute chose parle, où le cœur est à nu !
Quand, avec tant de force, eut-on tant d’espérance ?
Innocente bravoure, audace de l’enfance !
Nous croyions l’heure prête et le moment venu ;
Nous étions fiers et fous, mais nous avions la France.
Songe étrange ! il est mort, et tout s’est endormi.
Comment une espérance et si juste et si belle
Peut-elle devenir inutile et cruelle ?
Il est mort l’an dernier, et son deuil est fini,
La sanglante masure est changée en chapelle.
Qui nous dira le reste, et quel âge a l’oubli ?Il n’est pas tombé seul en allant à Neuilly.
Sur neuf que nous étions, marchant en compagnie,
Combien sont morts ! — Albert, son jeune et brave ami,
Et Montemart, et toi, pauvre Laborderie,
Qui te hâtais d’aimer pour jouir de la vie,
Le meilleur de nous tous et le premier parti !Si le regret vivait, vos noms seraient célèbres,
Amis ! — Que cette sombre et triste déité
Qui prête à notre temps sa tremblante clarté
Vous éclaire en passant de ses torches funèbres,
Et nous, enfants perdus d’un siècle de ténèbres,
Tenons-nous bien la main dans cette obscurité !Car la France, hier encor la maîtresse du monde,
A reçu, quoi qu’on dise, une atteinte profonde,
Et, comme Juliette, au fond des noirs arceaux,
À demi réveillée, à demi moribonde,
Trébuchant dans les plis de sa pourpre en lambeaux,
Elle marche au hasard, errant sur des tombeaux. votre commentaire
votre commentaire
-
Par sylvie erwan le 8 Mai 2019 à 08:20
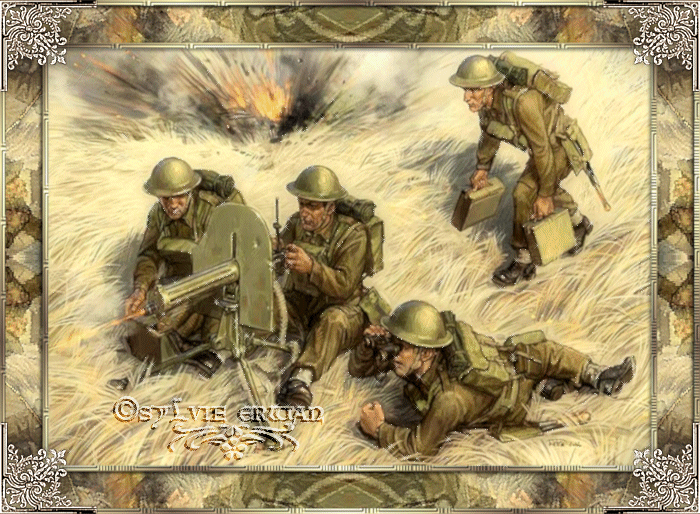

Beaucoup étaient là.
La fête battait son plein et l'insouciance régnait.
Un monde défilait. D’autres se défilaient.
Ici, les chants et la fête ! Ailleurs, les chars.
Le pacifisme en réponse aux nazis.
L’inconscience oublieuse, face aux fusils.
Bientôt, un monde allait s’effondrer dans le sang.
La folie des hommes. Un nouvel affrontement.
Sur les routes, les soldats, les civils fuyaient.
Et le courage, l’audace. Reste le désespoir.
L’insouciance se payait par ses heures noires.
L’incompétent fuit ses responsabilités.
Mais des voix, des hommes s’élèvent : Résistance !
Des hommes et des femmes franchissent la mer.
Et un général proclame l’éternel France.
Unissant, regroupant les forces volontaires.
Ils n’étaient pas tous là. Et certains s’égaraient.
Croyant l’internationale et non la patrie !
D’autres, un autre monde. Et collaboraient.
Notre France se déchirait à l’infini.
Mais un général proclame l’éternel France.
Unissant, regroupant des forces volontaires.
Des Hommes, des femmes rejoignent l’Angleterre
Car la voix de la France crie. Résistance !
Ils n’étaient pas tous là mais ils étaient nombreux.
Combattant pour l’honneur d’une France vaincue.
Sur mer, sur terre. En résistant courageux.
Soldats de l’ombre redressant l’honneur perdu.
Vous vous êtes bien battus. Vous avez résisté.
La France vous doit tant Soldats. La liberté.
Gérard Brazon votre commentaire
votre commentaire
-
Par sylvie erwan le 11 Novembre 2018 à 08:50
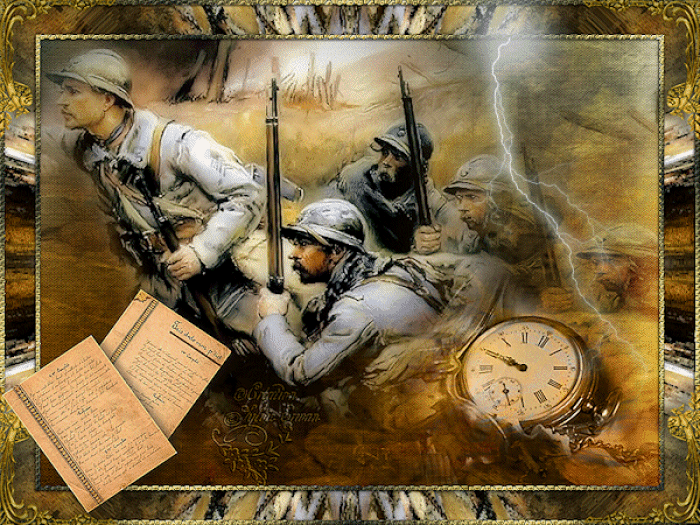

Pour ne pas oublier .
Le dernier jour de guerre 14-18 a fait près de 11 000 tués, blessés ou disparus.
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale.Ce qui s'est passé hier
peut ce reproduire demain
Si nous l'oublions aujourd'hui !
Voici une chanson de Moussu T e lei Jovents qui rend hommage aux « poilus ».Les paroles de la chanson :
Trois prénoms qu’ils ont donnés à mon père,
Comme un clin d’oe?il pour traverser le temps.
Trois prénoms pour trois garçons ordinaires
Pourtant tous morts avant d’avoir trente ans.
Que pensaient-ils en embrassant la mère,
Le matin où ils ont quitté leurs champs.
Il faut de l’or pour rester à l’arrière,
Ils vont au front, les fils de paysans.Paul, Émile et Henri,
Non, la mort n’est jamais belle.
Paul, Émile et Henri
Verdun, la Somme ou bien Gallipoli.Je ne suis pas doué pour chanter l’enfer,
C’est fait de boue, de vermine et de froid,
C’est fait de cris et de coups de tonnerre
Et de copains qui tombent autour de toi.
Ici, la mort ne fait pas de manières,
Elle en emporte cent à chaque fois,
Pauvres garçons mélangés à la terre,
Loin de chez eux, sans avoir su pourquoi.
La chanson de Craonne
Quand au bout d’huit jours le r’pos terminé
On va reprendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile
Mais c’est bien fini, on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le coeur bien gros, comm’ dans un sanglot
On dit adieu aux civ’lots
Même sans tambours, même sans trompettes
On s’en va là-haut en baissant la tête
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous des condamnés
Nous sommes les sacrifiés
Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance
Pourtant on a l’espérance
Que ce soir viendra la r’lève
Que nous attendons sans trêve
Soudain dans la nuit et le silence
On voit quelqu’un qui s’avance
C’est un officier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer
Doucement dans l’ombre sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous des condamnés
Nous sommes les sacrifiés
C’est malheureux d’voir sur les grands boulevards
Tous ces gros qui font la foire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous c’est pas la même chose
Au lieu d’se cacher tous ces embusqués
Feraient mieux d’monter aux tranchées
Pour défendre leur bien, car nous n’avons rien
Nous autres les pauv’ purotins
Tous les camarades sont enterrés là
Pour défendre les biens de ces messieurs-là
Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c’est pour eux qu’on crève
Mais c’est bien fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève
Ce s’ra vot’ tour messieurs les gros
D’monter sur le plateau
Et si vous voulez faire la guerre
Payez-la de votre peau
1917 Anonyme
En 1917, après le massacre du Chemin des Dames , où plus de 147 000 poilus ont été tués et plus de 100 000 blessés en deux semaines, les soldats se mutinent dans plus de 60 des 100 divisions de l’armée française. Ces révoltes furent très sévèrement réprimées, en particulier par Pétain [3] : il y eu plus de 500 condamnés à mort.
Cette chanson était interdite, et un million de francs-or plus la démobilisation immédiate furent promis à qui dénoncerait son auteur. Elle est restée anonyme... votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
cadres bonjour n bonsoir , fonds articles , poésies , astuces , conseils , santé , cadres saisons , cadres f^tes divers etc.3...