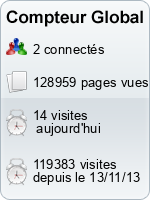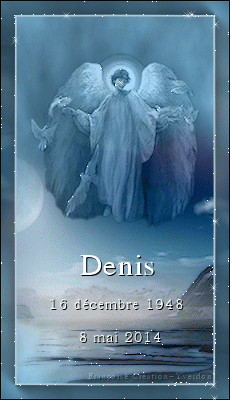-
Par sylvie erwan le 14 Novembre 2020 à 07:45


Le rossignol aveugle
Pauvre exilé de l’air ! Sans ailes, sans lumière,
Oh ! Comme on t’a fait malheureux !
Quelle ombre impénétrable inonde ta paupière !
Quel deuil est étendu sur tes chants douloureux !
Innocent Bélisaire ! Une empreinte brûlante
Du jour sur ta prunelle a séché les couleurs,
Et ta mémoire y roule incessamment des pleurs,
Et tu ne sais pourquoi Dieu fit la nuit si lente !
Et Dieu nous verse encor la nuit égale au jour.
Non ! Ta nuit sans rayons n’est pas son triste ouvrage.
Il ouvrit tout un ciel à ton vol plein d’amour,
Et ton vol mutilé l’outrage !
Par lui ton coeur éteint s’illumine d’espoir.
Un éclair qu’il allume à ton horizon noir
Te fait rêver de l’aube, ou des étoiles blanches
Ou d’un reflet de l’eau qui glisse entre les branches
Des bois que tu ne peux plus voir !
Et tu chantes les bois, puisque tu vis encore.
Tu chantes : pour l’oiseau, respirer, c’est chanter.
Mais quoi ! Pour moduler l’ennui qui te dévore,
Sous le voile vivant qui te cache l’aurore,
Combien d’autres accents te faut-il inventer !
Un coeur d’oiseau sait-il tant de notes plaintives ?
Ah ! Quand la liberté soufflait dans tes chansons,
Qu’avec ravissement tes ailes incaptives
Dans l’azur sans barrière emportaient ses leçons !
Douce horloge du soir aux saules suspendue,
Ton timbre jetait l’heure aux pâtres dispersés ;
Mais le timbre égaré dans ta clarté perdue
Sonne toujours minuit sur tes chants oppressés.
Tes chants n’éveillent plus la pâle primevère
Qui meurt sans recevoir les baisers du soleil,
Ni le souci fermé sous le doigt du sommeil
Qui se rouvre baigné d’une rosée amère ;
Tu ne sais plus quel astre éclaire tes instants ;
Tu bois, sans les compter, tes heures de souffrance ;
Car la veille sans espérance
Ne sent pas la fuite du temps !
Tu ne vas plus verser ton hymne sur la rose,
Ni retremper ta voix dans le feu qui l’arrose.
Cette haleine d’encens, ce parfum tant aimé,
C’est l’amour qui fermente au fond d’un coeur fermé ;
Et ton coeur contre ta cage
Se jette avec désespoir ;
Et l’on rit du vain courage
Qui heurte ton esclavage
Sur un barreau sanglant que tu ne peux mouvoir.
Du fond de ton sépulcre un cri lent et sonore
Dénonce tes malheurs autre part entendus ;
Ton oeil vide s’ouvre encore
Pour saluer une aurore
Que l’homme n’éteindra plus !
Ce jour que l’esclave envie
Du moins changera son sort,
Et je sais trop de la vie,
Pour médire de la mort !
Chante la liberté, prisonnier ! Dieu t’écoute.
Allons ! Nous voici deux à chanter devant lui.
J’ai su dire ma joie, et je sais aujourd’hui
Ce qu’un son douloureux te coûte !
Chante pour tes bourreaux qui daignent te nourrir,
Qui t’ont ravi des cieux la flamme épanouie :
Tes cris font des accords, ton deuil les désennuie ;
Si ta douleur s’enferme, ils te feront mourir !
Chante donc ta douleur profonde,
Ton désert au milieu du monde,
Ton veuvage, ton abandon ;
Dis, dis quelle amertume affreuse
Rend la liberté douloureuse
Pour qui n’en sait plus que le nom !
Dis qu’il fait froid dans ta pensée,
Comme quand une voix glacée
Souffla sur le feu de mon coeur
Pour éteindre aussi la lumière
D’une espérance, – la première,
Que je prenais pour le bonheur !
Laisse ton hymne désolée,
Comme l’eau dans une vallée,
S’épancher sur tes sombres jours,
Et que l’espoir filtre toujours
Au fond de ta joie écoulée !
Marceline Desbordes-Valmore
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sylvie erwan le 11 Novembre 2020 à 07:55
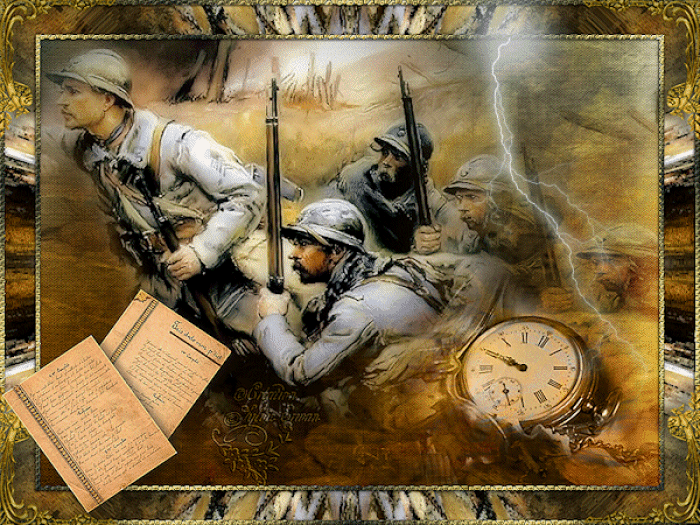



Sur les no man’s land défigurés
Sur les barbelés rouillés
Sur les paysages dévastés
J’écris ton nom
Sur le froid et dans l’effroi
Sur la terre détrempée
Sur le soleil effacé
J’écris ton nom
Sur les baïonnettes ensanglantées
Sur les obus éclatés par milliers
Sur les grenades mortifères lancées
J’écris ton nom
Sur les croix de bois des alliés
Sur les casques de corps inanimés
Sur les fusils des compagnons mutilés
J’écris ton nom
Sur les cigarettes partagées
Sur l’amitié pour se réchauffer
Sur la perte des frères des tranchées
J’écris ton nom
Sur le bonheur qui s’enfuit
Sur les « je t’aime »au goût amer
Sur les lettres d’amour inachevées
J’écris ton nom
Sur les larmes de mères éplorées
Sur les coeurs brisés
Sur le deuil de l’arrière délaissé
J’écris ton nom
Sur les regrets d’Héphaïstos, maître des armes qui consument
Sur la lassitude d’Arès qui envoie des âmes innocentes aux Enfers
Sur les épaules de Thanatos qui croulent sous le poids des hurlements
J’écris ton nom
Pour la mémoire de chacun
En souvenir de tous ces hommes tombés
Et pour ne pas recommencer les erreurs du passé
Je viens pour t’acclamer
PAIX 1 commentaire
1 commentaire
-
Par sylvie erwan le 7 Novembre 2020 à 07:30


La maison de ma mère
Maison de la naissance, ô nid, doux coin du monde !
Ô premier univers où nos pas ont tourné !
Chambre ou ciel, dont le coeur garde la mappemonde,
Au fond du temps je vois ton seuil abandonné.
Je m’en irais aveugle et sans guide à ta porte,
Toucher le berceau nu qui daigna me nourrir.
Si je deviens âgée et faible, qu’on m’y porte !
Je n’y pus vivre enfant, j’y voudrais bien mourir,
Marcher dans notre cour où croissait un peu d’herbe,
Où l’oiseau de nos toits descendait boire et puis,
Pour coucher ses enfants, becquetait l’humble gerbe,
Entre les cailloux bleus que mouillait le grand puits !
De sa fraîcheur lointaine il lave encor mon âme,
Du présent qui me brûle il étanche la flamme,
Ce puits large et dormeur au cristal enfermé
Où ma mère baignait son enfant bien-aimé.
Lorsqu’elle berçait l’air avec sa voix rêveuse,
Qu’elle était calme et blanche et paisible le soir,
Désaltérant le pauvre assis, comme on croit voir
Aux ruisseaux de la bible une fraîche laveuse !
Elle avait des accents d’harmonieux amour
Que je buvais du coeur en jouant dans la cour.
Ciel ! Où prend donc sa voix une mère qui chante
Pour aider le sommeil à descendre au berceau ?
Dieu mit-il plus de grâce au souffle d’un ruisseau ?
Est-ce l’éden rouvert à son hymne touchante,
Laissant sur l’oreiller de l’enfant qui s’endort,
Poindre tous les soleils qui lui cachent la mort ?
Et l’enfant assoupi, sous cette âme voilée,
Reconnaît-il les bruits d’une vie écoulée ?
Est-ce un cantique appris à son départ du ciel,
Où l’adieu d’un jeune ange épancha quelque miel ?
Merci, mon Dieu ! Merci de cette hymne profonde,
Pleurante encore en moi dans les rires du monde,
Alors que je m’assieds à quelque coin rêveur
Pour entendre ma mère en écoutant mon coeur :
Ce lointain au revoir de son âme à mon âme
Soutient en la grondant ma faiblesse de femme ;
Comme au jonc qui se penche une brise en son cours
A dit : » Ne tombe pas ! J’arrive à ton secours. «
Elle a fait mes genoux souples à la prière.
J’appris d’elle, seigneur, d’où vient votre lumière,
Quand j’amusais mes yeux à voir briller ses yeux,
Qui ne quittaient mon front que pour parler aux cieux.
A l’heure du travail qui coulait pleine et pure,
Je croyais que ses mains régissaient la nature,
Instruite par le Christ, à sa voix incliné,
Qu’elle écoutait priante et le front prosterné.
Vraiment, je le croyais ! Et d’une foi si tendre
Que le Christ au lambris me paraissait l’entendre :
Je voyais bien que, femme, elle pliait à Dieu,
Mais ma mère, après lui, l’enseignait en tout lieu.
L’ardent soleil de juin qui riait dans la chambre,
L’âtre dont les clartés illuminaient décembre,
Les fruits, les blés en fleur, ma fraîche nuit, mon jour,
Ma mère créait tout du fond de son séjour.
C’était ma mère ! ô mère ! ô Christ ! ô crainte ! ô charmes !
Laissez tremper mon coeur dans vos suaves larmes ;
Laissez ces songes d’or éclairer les vieux murs
Des pauvres innocents nés dans les coins obscurs ;
Laissez, puisqu’ici-bas nous nous perdons sans elles,
Des mères aux enfants comme aux oiseaux des ailes.
Quand la mienne avait dit : » Vous êtes mon enfant ! «
Le ciel, c’était mon coeur à jour et triomphant ! …
Elle se défendait de me faire savante :
» Apprendre, c’est vieillir, disait-elle, et l’enfant
Se nourrira trop tôt du fruit que Dieu défend,
Fruit fiévreux à la sève aride et décevante.
L’enfant sait tout qui dit à son ange gardien :
– » Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ! «
C’est assez demander à cette vie amère,
Assez de savoir suivre et regarder sa mère,
Et nous aurons appris pour un long avenir
Si nous savons prier, nous soumettre et bénir ! «
Et je ne savais rien à dix ans qu’être heureuse,
Rien que jeter au ciel ma voix d’oiseau, mes fleurs ;
Rien, durant ma croissance aigüe et douloureuse,
Que plonger dans ses bras mon sommeil ou mes pleurs.
Je n’avais rien appris, rien lu que ma prière.
Quand mon sein se gonfla de chants mystérieux,
J’écoutais notre-dame et j’épelais les cieux,
Et la vague harmonie inondait ma paupière ;
Les mots seuls y manquaient, mais je croyais qu’un jour
On m’entendrait aimer pour me répondre : amour !
Les psaumes de l’oiseau caché dans le feuillage,
Ce qu’il raconte au ciel par le ciel répondu,
Mon âme qu’on croyait indolente ou volage,
L’a toujours entendu !
Et quand là-bas, là-bas, comme on peint l’espérance,
Dieu montrait l’arc-en-ciel aux pèlerins errants,
S’il avait ruisselé sur ma vierge souffrance,
La nuit se sillonnait de songes transparents ;
Et sur l’onde qui glisse et plie, et s’abandonne,
Quand j’avais amassé des parfums purs et frais,
En voyant fuir mes fleurs que n’attendait personne,
Je regardais ma mère et je les lui montrais.
Et ma mère disait : » C’est une maladie,
Un mélange de jeux, de pleurs, de mélodie :
C’est le coeur de mon coeur ! Oui, ma fille ! Plus tard,
Vous trouverez l’amour et la vie… autre part. «
Innocence ! Innocence ! éternité rêvée !
Au bout des temps de pleurs serez-vous retrouvée ?
êtes-vous ma maison que je ne peux rouvrir ?
Ma mère ! Est-ce la mort ? … je voudrais bien mourir !
Marceline Desbordes-Valmore
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
cadres bonjour n bonsoir , fonds articles , poésies , astuces , conseils , santé , cadres saisons , cadres f^tes divers etc.3...