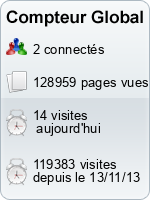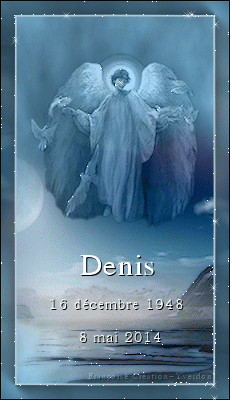-


Le balcon
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs !
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m'était doux ! que ton coeur m'était bon !
Nous avons dit souvent d'impérissables choses
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
Que l'espace est profond ! que le coeur est puissant !
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur ! ô poison !
Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison.
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton coeur si doux ?
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses !
Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis,
Renaîtront-il d'un gouffre interdit à nos sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes ?
- Ô serments ! ô parfums ! ô baisers infinis !
Charles Baudelaire
1821 - 1867 votre commentaire
votre commentaire
-


À ma mèreC’est une vieille fille en cheveux blancs ; elle est
Pâle et maigre ; un antique et grossier chapelet
S’égrène, machinal, sous ses doigts à mitaines.
Sans cesse remuant ses lèvres puritaines
D’où tombent les Pater noster et les Ave,
Et laissant son tricot de laine inachevé,
Droite, elle prie, assise au coin d’un feu de veuve,
Dans sa robe de deuil rigide et toujours neuve.Le logis est glacé comme elle. Le cordeau
Semble avoir aligné les plis droits du rideau,
Que blêmit le reflet pâle d’un jour d’automne ;
Et, s’il vient un rayon de soleil, il détonne
Et sur le sol découpe un grand carré brutal.
Le lit est étriqué comme un lit d’hôpital.
L’heure marche sans bruit sous son globe de verre.
Tout est froid, triste, gris, monotone et sévère ;
Et près du crucifix penché comme un fruit mûr,
Deux béquilles d’enfant, en croix, pendent au mur.C’est une histoire simple et très mélancolique
Que raconte l’étrange et lugubre relique :
Les baisers sur les mains froides des vieux parents ;
La bénédiction tremblante des mourants ;
Et puis deux orphelins tout seuls, le petit frère
Infirme, étiolé, qui souffre et qui se serre,
Frileux, contre le sein d’un ange aux cheveux blonds ;
La grande sœur, si pâle avec ses voiles longs,
Qui, la veille, devant le linceul et le cierge,
Jurait aux parents morts, à Jésus, à la Vierge,
D’être une mère au pauvre enfant, frêle roseau ;
Ce sont les petits bras tendus hors du berceau,
La douleur apaisée un instant par un conte,
L’insomnie et la voix de l’horloge qui compte
L’heure très lentement, les réveils pleins d’effrois,
Les soins donnés, les pieds nus sur les carreaux froids,
Les baisers appuyés sur la trace des larmes,
Et la tisane offerte, et les folles alarmes,
Et le petit malade à l’aurore n’offrant
Qu’un front plus pâle et qu’un sourire plus navrant.Ce dévoûment obscur a duré dix années,
Beauté, jeunesse, fleurs loin du soleil fanées,
Tout fut sacrifié sans plainte et sans regret ;
Et quand, par les beaux soirs, un instant elle ouvrait
À la brise de mai charmante et parfumée
La fenêtre toujours par prudence fermée
Et laissait ses regards errer à l’horizon,
Une toux de l’enfant refermait sa prison.Elle est libre aujourd’hui.
C’est une pauvre vieille,
Toujours en deuil, dévote, ascétique, pareille
Aux béguines qu’on voit errer dans le couvent.
Libre ! Pauvre âme simple et douce ! Bien souvent
Elle songe, très triste, à son cher esclavage,
Et, tout bas, d’une voix sourde, presque sauvage,
Elle dit : « Il est mort ! » Puis elle s’attendrit,
Et reprend : « Il avait déjà beaucoup d’esprit.
Quand il était méchant, il m’appelait madame.
Il est mort ! Le bon Dieu l’a pris. Sa petite âme
À des ailes. Il est un ange au paradis.
Sans quoi serait-il mort ? Quelquefois je me dis
Que Dieu prend les enfants pour en faire des anges.
Puis il avait des mots et des regards étranges :
Peut-être qu’il était ange avant d’être né ?
Tes pleurs de chaque jour, ô pauvre condamné,
Valent bien tous les longs Oremus qu’on prodigue.
Puis un signe de croix était une fatigue
Pour son bras. Il savait sourire, et non prier.
Il est mort ! Une nuit, je l’entendis crier.
J’accourus, je penchai la tête vers sa couche,
Et sa dernière haleine a passé sur ma bouche,
Et depuis ce temps-là je n’ai plus de gaîté.
Le lendemain, des gens sombres l’ont emporté.
Pauvre martyr ! Sa bière était toute petite !
J’ai laissé sur son cœur sa médaille bénite.
Cela fera plaisir au bon Dieu, n’est-ce pas ?
Il est au Ciel. Hélas ! est-il heureux là-bas ?
Les anges, on se fait parfois de ces chimères,
Ont-ils soin des enfants aussi bien que les mères ?
Je doute. Pardonnez, Seigneur, à mon regret ! »
Et baissant ses grands yeux où l’âme transparaît,
Elle active le cours rythmique et monotone
De son lent chapelet. Et le soleil d’automne,
Qui dore les carreaux de ses rayons tremblants,
Met de vagues lueurs parmi ses cheveux blancs.François Coppée, Le Reliquaire, 1866
 votre commentaire
votre commentaire
-


A ma mère
« Ô Claire, Suzanne, Adolphine,
Ma Mère, qui m'étiez divine,
Comme les Maries, et qu'enfant,
J'adorais dès le matin blanc
Qui se levait là, près de l'eau,
Dans l'embrun gris monté des flots,
Du fleuve qui chantait matines
À voix de cloches dans la bruine ;
Ô ma Mère, avec vos yeux bleus,
Que je regardais comme cieux,
Penchés sur moi tout de tendresse,
Et vos mains elles, de caresses,
Lorsqu'en vos bras vous me portiez
Et si douce me souriiez,
Pour me donner comme allégresse
Du jour venu qui se levait,
[…] »
Max Elskamp (1862-1931) votre commentaire
votre commentaire
-


Mon fils, mon grand garçon
Mon fils, mon grand garçon, le temps passe trop vite,
Tu renies notre amour, tu veux partir, déjà,
Tu rêves que tu fuies, et qu’enfin tu nous quittes ;
Pourtant, pour t’accueillir, je serai toujours là.Tu t’enfonces, te perds dans une absurde errance,
Tu refuses d’emblée que l’on guide tes pas ;
Sache que pour t’aider, te redonner confiance
Ou bercer tes chagrins, je serai toujours là.Tu te crois malheureux, souvent tu te rebelles,
Tu te venges d’un sort que tu dis bien ingrat,
Mais la vie te sourit, passionnante et si belle…
Pour te le rappeler, je serai toujours là.Isabelle Callis-Sabot
 votre commentaire
votre commentaire
-


Souvenirs d’enfance
O frère, ô jeune ami, dernier fils de ma mère,
O toi qui devanças, dans le val regretté,
Cette enfant, notre sœur, une rose éphémère,
Qui ne vécut qu’un jour d’été ;Que fais-tu, cher absent, ô mon frère ! à cette heure
Où mon cœur et mes yeux se retournent vers toi ?
Ta pensée, évoquant les beaux jours que je pleure,
Revole-t-elle aussi vers moi ?Souvent dans mon exil, je rêve à notre enfance,
A nos matins si purs écoulés sous les bois,
Et sur mon front le vent des souvenirs balance
Les molles ombres d’autrefois.Pour tromper les ennuis d’un présent bien aride
Pour rafraîchir mon pied que la route a lassé,
Je remonte, songeur, à la source limpide
Qui gazouille dans mon passé.De nos beaux jours c’était le matin et le rêve :
Tout était joie et chants, fleurs et félicités !
O bonheurs des enfants que le temps nous enlève,
Pourquoi nous avez-vous quittés ?Nous étions trois alors. Éveillés dès l’aurore,
Sortant du nid à l’heure où l’aube sort du ciel,
Nous allions dans les fleurs qu’elle avait fait éclore
Boire la rosée et le miel.Elle et toi, de concert à ma voix indociles,
Vous braviez du soleil les torrides chaleurs.
Quand ma mère accourait, l’arbre aux ombres mobiles
Voilait nos plaisirs querelleurs.Elle avait tout vu. Quittant le frais ombrage,
Nous lisions notre faute à son front rembruni.
Moi – j’étais votre aîné – bien qu’étant le plus sage,
Je n’étais pas le moins puni.Nous la suivions. Bientôt, trompant sa vigilance,
Nous revolions aux champs, au grand air, au soleil,
Et des bois assoupis, tiède abri du silence,
Nous allions troubler le sommeil.Alors, malheur à l’arbre à la grappe embaumée,
Au fruit d’or rayonnant à travers les rameaux !
Nous brisions branche et fruits, la grappe et la ramée,
Et jusqu’aux nids des tourtereaux.Et puis nous descendions la pente des ravines,
Où l’onde et les oiseaux confondaient leurs chansons,
Nous heurtant aux cailloux, nous blessant aux épines
Des framboisiers et des buissons.Un lac était au bas, large, aux eaux peu profondes.
Sur ses bords qu’ombrageait le dais mouvant des bois,
Avec les beaux oiseaux furtifs amis des ondes,
Enfants, nous jouions tous les trois.Pour suivre sur les flots leur caprice sauvage,
Des troncs du bananier nous faisions un radeau,
Et sur ce frêle esquif, glissant près du rivage,
Nous poursuivions les poules d’eau.Ma sœur, trempant ses pieds dans l’onde claire et belle,
Comme la fée-enfant de ces bords enchanteurs,
Jetait aux bleus oiseaux qui nageaient devant elle
Des fruits, des baisers et des fleurs.Et puis nous revenions. Notre mère, inquiète,
Pour nous punir s’armant de sévères froideurs,
Nous attendait au seuil de l’humble maisonnette,
Heureuse, avec des mots grondeurs.O chagrin des enfants, qu’aisément tu désarmes
Les mères ! Nous donnant et des fruits et du lait,
Elle mêlait aux mots qui nous coûtaient des larmes
Le baiser qui nous consolait.Ainsi coulaient nos jours. – O radieuse aurore !
O mes doux compagnons, je crois vous voir encore !
Bonheurs évanouis des printemps révolus,
Soleils des gais matins qui ne m’éclairez plus,
A vos jeunes chaleurs rajeunissant mon être,
Je sens mon cœur revivre et mon passé renaître !
Je vous retrouve enfin ! Je vois là, sous mes yeux,
Courir sur les gazons mes souvenirs joyeux.
Je vois, de notre mère oubliant la défense,
Par les grands champs de riz voltiger notre enfance.
Chassons le papillon, l’insecte, les oiseaux,
Glanons un fruit tombé sur le cristal des eaux ;
C’est le ravin, le lac aux vagues argentines,
Le vieil arbre ombrageant nos têtes enfantines ;
C’est toi, c’est notre mère aux yeux pleins de douceur !
C’est moi, c’est… ; ô mon frère ! où donc est notre sœur ?Un tertre vert, voilà ce qui nous reste d’elle !
Quand une âme est si blanche, à lui Dieu la rappelle.
Tige, orgueil de nos champs et que la brise aimait,
Tout en elle brillait, fleurissait, embaumait.
Lys sans tache, à la vie elle venait d’éclore,
Douce comme un parfum, blonde comme une aurore !
Le soleil à ses jours mesurait les chaleurs ;
Des roses du Bengale elle avait les pâleurs.
Oh ! les fins cheveux d’or ! Les nouvelles épouses
Du bonheur de ma mère, hélas ! étaient jalouses.
Toutes lui faisaient fête et, des mains et des yeux
Caressant de son front l’ovale harmonieux,
Demandaient au Seigneur, d’une lèvre muette,
Un blond enfant semblable à cette blonde tête !
Nos Noirs, comme ils l’aimaient ! Dans leur langue de feu
Ils la disaient l’étoile et la fille de Dieu.
Naïfs, ils comparaient cette fleur des savanes
Aux fraîches visions qui hantent les cabanes :
C’était un bon génie, une âme douce aux Noirs ;
Et, lorsque du labour ils revenaient, les soirs,
Tous, ils lui rapportaient des nids et des jam-roses,
Ou le bleu papillon, amant ailé des roses.
Hélas ! que vous dirais-je encor de notre sœur ?
Elle était tout pour nous, grâce et fée, astre et fleur ;
L’ange de la maison au nimbe d’innocence ;
La tige virginale, et le palmier d’enfance
Qui, croissant avec nous sous les yeux maternels,
Mêlait à nos rameaux ses rameaux fraternels.
C’est ma nourrice aussi qui l’avait élevée :
Nous étions presque enfants d’une même couvée ;
Oiseaux à qui le ciel faisait des jours pareils,
Un même nid le soir berçait nos longs sommeils.
Temps heureux ! Et la mort ! ô deuil ! ma pauvre mère !…
Elle vint après nous et s’en fut la première.
Sous un souffle glacé j’ai vu ployer son corps ;
L’ange froid des tombeaux éteignit sa prunelle,
Et, loin d’un sol en pleurs l’emportant sur son aile,
Ensemble ils sont partis pour le pays des morts.Sa tombe ?… Elle est au pied de la haute colline
Dont le front large et nu sur l’Océan s’incline ;
Où la vague aux soupirs des mornes filaos
Vient mêler jour et nuit ses lugubres sanglots,
Et semble pour les morts, d’une voix solennelle,
Chanter le Requiem de sa plainte éternelle.Paris, 1840.
Auguste Lacaussade, Poèmes et Paysages
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
cadres bonjour n bonsoir , fonds articles , poésies , astuces , conseils , santé , cadres saisons , cadres f^tes divers etc.3...